Et maintenant, quelles actions et quelles alliances pour faire ensemble ?
Comment conclure et prolonger une édition foisonnante de POP MIND qui a vu plus de 400 inscrit·es, 44 temps de rencontre et d’ateliers, ainsi que des temps festifs et artistiques dans cinq lieux partenaires ?
Avec le mot d’ordre « Ouvrir les yeux, lever les poings, serrer les coudes », POP MIND 2024 a opposé l’intelligence collective, la coopération, l’ouverture et les actions à un constat accablant sur l’état du monde et la multiplication des crises. Face au risque de démobilisation et découragement, les participant·es ont voulu opposer l’optimisme de la volonté et la richesse de pensées, d’expériences et de mobilisations appelées à converger.
Le croisement entre l’UFISC et le CRID, ainsi que des plus de trente organisations coorganisatrices, a élargi les horizons, et le bouillonnement de ces trois jours appelle à une recherche de solutions collectives, élargies à l’échelon local comme à l’échelon international.
La singularité de cette édition 2024 de POP MIND est d’avoir réuni à l’Antipode deux écosystèmes à la fois différents mais convergents autour de l’UFISC et du CRID. D’où un éventail très large de sujets qui convergent pourtant en un point : la défense des droits humains comme du droit des non humains.
Pour dégager des signaux forts et faibles, et surtout ouvrir des perspectives d’espoir et d’action, la plénière conclusive de ce POP MIND rennais, animée par Patricia Coler et Germain Filoche, s’est déroulée en trois temps :
- Un point de vue d’élu·es proposant des perspectives politiques.
- Une lecture sensible par trois rapporteur·ses aux regards divers.
- Un bilan tracé par les représentant·es des trois organisateurs : le CRID, l’UFISC, et l’Antipode.
Sommaire du document
Un archipel de luttes
1.1. Décoloniser le regard
1.2. Renforcer le monde associatif : le temps et les moyens
L’urgence des dépassements
2.1. Le pessimisme du constat
2.2. Archipels et passerelles
Pensées, action, participation
3.1. Faire, et faire ensemble
3.2. Quelles méthodes et quels pas ?
3.3. Penser ensemble droits culturels et développement soutenable
Ensemble, des solutions
4.1. Joie et bonheur
4.2. Assumer le politique
4.3. Assumer le sensible
4.4. Passer à l’offensive
1. Un archipel de luttes
1.1. Décoloniser le regard
La plénière « Environnement et droits des peuples » proposée par le CRID a précisément offert un nouveau champ de réflexion à POP MIND en abordant les enjeux liés à l’eau. Il s’inclut dans la question des droits culturels, dans la mesure où la question de l’eau invite à se placer du point de vue d’autres cultures, comme l’a exprimé Caroline Weill, chargée des partenariats éditoriaux à Ritimo et rapporteuse au regard international. Une thématique particulièrement prégnante a émergé : celle des dégâts de l’extractivisme et des luttes menées par les peuples autochtones, contre ses dégâts notamment en Amérique latine. L’extractivisme, qui voit de méga projets à ciel ouverts détruire les montagnes et assécher les sources d’eau, est la colonne vertébrale du capitalisme. Son impact est redoutable notamment sur les femmes des communautés andines sur lesquelles reposent les tâches liées à l’eau et qui sont particulièrement exposées aux dégâts de la pollution.
« Ces constats accablants interrogent aussi nos politiques environnementales, souligne Caroline Weill : la transition énergétique, telle qu’elle nous est vendue avec les solutions technologiques de la voiture électrique et des panneaux photovoltaïques, est toujours plus gourmande en lithium, au prix d’un impact catastrophique en termes de dépossession des communautés de leurs terres et d’assèchement ». De plus, l’extractivisme va de pair avec une production d’armes accrue et avec une répression toujours plus violente des mouvements écologistes, qui voit la gendarmerie française prêter main forte aux forces de l’ordre péruvienne pour réprimer les manifestant·es.
« Un constat qui ne peut qu’encourager à combattre pour une écologie profondément anticolonialiste, critique du capitalisme et féministe », conclut Caroline Weill, qui insiste aussi sur la nécessité de décoloniser les esprits en découvrant les auteur·ices latino·a américain·es travaillant sur ces sujets.
Délégué général du Collectif des Associations Citoyennes, Jean-Baptiste Jobard s’empare de cette réflexion pour souhaiter que les pensées du Sud puissent irriguer celles du Nord, citant à cet égard le travail remarquable de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants.
Après avoir suivi les ateliers consacrés aux libertés associatives, aux médias alternatifs et à la perspective de nouvelles sécurités sociales (alimentaire, culturelle), il tient à manifester son enthousiasme vis-à-vis de POP MIND : « un temps qui fait vraiment école, et pour lequel le rapprochement avec le CRID est particulièrement important ».
Cet enthousiasme, comment le prolonger, et comment continuer après POP MIND ? C’est le leitmotiv de cette plénière, dont le fil rouge pourrait être le refus de céder à l’accablement et au sentiment d’impuissance face à l’ampleur des crises écologique, sociale, démocratique et la montée de l’extrême droite.
1.2. Renforcer le monde associatif : le temps et les moyens
Jean-Baptiste Jobard affirme l’impératif d’œuvrer au renforcement de ce monde associatif et fait part de deux préoccupations à cet égard : le temps et l’argent.
En ce qui concerne les moyens, il constate que des fondations progressistes se rendent compte que dans le cadre du risque d’une montée de régimes autoritaires, la philanthropie actuelle doit être actualisée pour renforcer les défenseurs des droits fondamentaux. De même un groupement issu de l’ESS vient de lancer l’opération « un milliard d’euros pour la transformation écologique et solidaire ». Le chiffre est très insuffisant par rapport aux besoins mais illustre une capacité d’auto-organisation pour une prise en charge de l’urgence, notamment du côté des coopératives. Le rapport du CESE sur le financement associatif qui vient d’être voté à l’unanimité montre que la société civile comprend cet enjeu crucial et propose des solutions.
Mais quelle prise en compte par les politiques ? Car la question du temps pose celle des suites et des débouchés politiques de POP MIND. Jean-Baptiste Jobard invite à se saisir de l’échéance des élections municipales pour inviter les candidat·es à se positionner sur les 32 mesures du Pacte pour la transition et à favoriser des rapprochements pour une transition citoyenne, qui permettent de nouer des relations avec d’autres responsables associatifs et syndicaux. « Face à la multiplication des crises, nous devons tous·tes faire et proposer les premiers petits pas possibles ! » conclut-il.
D’un côté les urgences, de l’autre le temps long de la transformation et du travail individuel et collectif : Noémie Barillet, psychologue et stagiaire à la FRACAMA, travaille sur les dominations et est intervenue dans POP MIND dans un atelier consacré au racisme systémique qui n’épargne pas le secteur culturel. Combattre ce racisme, comme les autres formes de domination, exige l’écoute et l’attention à la parole de l’autre, et s’inscrit dans le temps long des générations.
2. L’urgence des dépassements
Les commentaires sur les ateliers montrent l’étendue des zones à défendre pour les droits humains, et la nécessité de faire alliance entre des organisations aux cultures et aux priorités diverses.
2.1. Le pessimisme du constat
« Car il y a urgence », répète Germain Filoche, responsable du pôle éducation populaire et formation du CRID dans un constat implacable : « Comment ne pas angoisser là où tout est fait pour l’angoisse, sur fond de guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et de guerre Israël Palestine qui nous horrifient chaque jour ? »
Il cite le dernier rapport d’Amnesty International qui constate un recul des droits humains dans le monde, la recrudescence des violences basées sur le genre, l’augmentation de la surveillance généralisée, la montée des extrêmes-droites partout dans le monde. « Qu’est ce qui permet de tenir ? s’interroge-t-il ; la pensée du long terme, l’ouverture et l’internationalisme ». Il cite à cet égard l’ouvrage de David Graeber et David Wengrow, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, qui déconstruit l’histoire linéaire et la vision rousseauisée de l’humanité passée des chasseurs cueilleurs en harmonie aux agriculteurs et aux hiérarchies sociales.
« Avoir un rapport déconstruit et décolonial à notre histoire ne relève pas de l’idéologie mais du pragmatisme : c’est ce qui permet d’être ouvert·es et curieux·es, ajoute-t-il. Par ailleurs, ce qui nous rend optimistes, c’est d’être ensemble et nombreux·ses : quand partout dans le monde, des militant·es mènent des luttes autour de la question de l’eau, ne pas se sentir seul·es rend optimiste ! On crée des espaces de coopération à long terme pour avoir un impact sur la réalité. »
2.2. Archipels et passerelles
Alban Cogrel, coprésident de l’UFISC et président de la FAMDT, insiste sur cette dimension coopérative :
« La richesse de l’UFISC, c’est notre diversité qui s’inscrit dans un champ professionnel traversé par des controverses et une complexité. “Ouvrir les yeux, lever les poings, serrer les coudes”, on l’a fait pendant trois jours, mais on a aussi réussi à nous dépasser. Le défi et le moment critique qu’on traverse nous demande de nous mettre en responsabilité pour construire des alliances et des coopérations. Et la dimension internationale, qui a parfois du mal à être embrassée par nos champs artistiques et culturels est à cet égard importante. »
Il insiste sur d’autres coopérations à travailler : avec les collectivités territoriales, pour « construire en dentelle des coopérations renouvelées et faire avec ce qui compose notre démocratie ». Il souligne enfin l’importance de la relation au vivant, et de la remise en question du système capitaliste et productiviste pour aller vers des futurs désirables. Autant d’archipels qu’il s’agit de relier pour une convergence des luttes.
3. Pensées, action, participation
Invité·es à faire part de leurs observations et perspectives, Tristan Lahais, vice-Président à la Culture et la vie étudiante de Rennes métropole, et Béatrice Macé, vice-Présidente à la Région Bretagne en charge de la culture, des droits culturels et de l’éducation artistique et culturelle, ont livré deux réflexions complémentaires : le premier invite à une nouvelle étape de la démocratie en actes, la seconde au temps de la réflexion et de la définition des axes d’une autre politique autour du développement durable et des droits culturels.
3.1. Faire, et faire ensemble
Au temps de la déconstruction doit succéder celui de la construction : c’est ce que dit en substance Tristan Lahais, qui partage les constats émis précédemment : « Il y a convergence des luttes parce qu’il y a convergence des crises. La crise démocratique qui montre que le progressisme ne va pas de soi ; la crise sociale qui voit les dominants appuyer toujours plus sur les dominé·es, la crise écologique et le risque de la fin de l’humain. Le besoin de la mobilisation humaine n’est pas un horizon mais un impératif. Il n’y aura pas toujours d’échappatoire même pour les dominants. »
Quelle mobilisation ? Peut-être est-il temps de critiquer la posture critique, estime-t-il. « La culture politique de la gauche, souligne-t-il, reste très imprégnée par l’idéologie marxiste de la déconstruction : briser les chaînes du prolétariat suffirait. Mais l’émergence de la question écologique amène la question des ressources finies et l’impératif de non seulement briser les chaînes mais d’inventer un monde souhaitable dans nos manières de produire et de consommer. Cela pose des questions de méthodes : d’événements en événements, on tend à privilégier la culture de la déconstruction plutôt que du faire et du faire ensemble. »
3.2. Quelles méthodes et quels pas ?
Lui souligne deux écueils : l’alarmisme excessif et les horizons impossibles, fixés parfois par l’État qui ne donne pas les moyens afférents aux collectivités. À l’échelle de la métropole de Rennes, par exemple, il propose de franchir un nouveau seuil dans le « faire ensemble ». Plutôt que de proposer un budget participatif résiduel objet de concurrence entre les associations, inviter ces dernières en amont de la construction du budget pour que les contraintes soient directement partagées.
Dans le champ culturel, il souligne l’urgence de sortir du dilemme entre risque d’instrumentalisation des acteurs et libertés associatives, citant l’exemple de l’Écomusée de Rennes, centre de l’interprétation de l’urbanisme et du patrimoine rennais qui a associé des acteurs culturels à la construction de récits sur le paysage, les sols, la culture, la villes et les campagnes et à la perspective de futurs désirables. Autre exemple source d’optimisme : l’événement Nos futurs aux Champs libres, qui laisse la clef du plus grand équipement de la région Bretagne à des groupes de jeunes issus de tous horizons, pour une programmation sur le thème des futurs et des mondes en transition. « Un énorme succès : 20 000 jeunes y ont participé et ont montré une vraie radicalité sur ces questions qui travaillent précisément la convergence des actions ! »
L’action dans la recherche des solutions : ce pourrait être le condensé de son intervention qui invite à une mobilisation à la hauteur de la crise.
3.3. Penser ensemble droits culturels et développement soutenable
« Il faut poser les conditions de la pensée », dit pour sa part Béatrice Macé, vice-présidente à la culture, aux droits culturels et à l’EAC de la région Bretagne. Pour elle, les droits culturels sont la pensée du développement durable, une nouvelle éthique de la pensée, dont elle définit les piliers : « Le développement durable – mauvaise traduction de l’anglais “sustainable”– c’est une nouvelle expression de l’intérêt général qui tourne le dos au “Après moi, le déluge”. Son pivot, c’est le principe de responsabilité tant pour les élu·es que pour les non élu·es : répondre de nos actes, dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit et en répondre et intégrer les conséquences de l’action à la réflexion. »
Cela passe par plusieurs principes et exigences :
- L’arrêt du travail en solo et en silos au profit de la complémentarité ;
- La solidarité avec toutes les personnes de l’écosystème ;
- La participation : travailler ensemble et respecter l’autre.
« C’est là qu’entrent en jeu les droits culturels, précise-t-elle, et la dignité de la personne : ce que la personne considère comme convenable pour elle pour être reconnue comme humain. Le convenable croise le soutenable. Ce qui m’intéresse est de parvenir au croisement de développement durable et droits culturels dans la politique régionale. La région Bretagne a intégré le développement durable en 2005 avec le bien-vivre. Dans ce cadre, je travaille le bien être des personnes avec un principe de cohésion territoriale : aller au plus près des populations avec les pactes de développement culturel et organiser une consultation populaire, pour ne pas penser à la place des personnes. » Dans cette politique, elle a proposé que l’Éducation artistique et culturelle soit un outil au service des droits culturels. Elle en donne une définition issue de l’étymologie ex-ducere : « conduire hors » de l’autorité du maître.
« Croiser la diversité culturelle avec la biodiversité, c’est prendre en compte toute la diversité du vivant, conclut-elle. Pour travailler ensemble, il faut construire cette cohérence entre les droits culturels et le développement durable, travailler ensemble en se parlant pour éviter les malentendus et erreurs du passé. »
4. Ensemble, des solutions
4.1. Joie et bonheur
La plénière a été rythmée de temps de débats avec les participant·es. L’humeur est combative et se veut joyeuse malgré l’état des lieux.
Stéphanie Thomas-Bonnetin, directrice de l’Antipode, a donné le ton : « Je suis radicalement optimiste parce que je vois évoluer les jeunes et les enfants à l’Antipode. La joie et le bonheur qu’on voit chez les jeunes, sont des éléments fondamentaux des combats. Et des ingrédients essentiels de la transformation ! » Elle souligne que les participant·es sont déjà beaucoup dans le faire ; notamment grâce aux réseaux. Ces espaces qui nourrissent les acteur·ices et s’interrogent sur leur régionalisation. Soulignant la chance de vivre en Bretagne, où existent des espaces de coconstruction avec les élu·es, qu’elle incite à transformer en espaces de codécision, elle s’interroge sur une régionalisation de l’action commune : « Peut-être est-ce le moment de faire un UFISC régional avec les acteur·ices breton·nes ? » et veut que « joie et bonheur » soit ses derniers mots pour conclure POP MIND.
4.2. Assumer le politique
Sur les trois jours de ce POP MIND, le plaisir est partagé, et iels sont plusieurs à témoigner de l’importance de se retrouver et d’élargir les contributions et thématiques.
« L’espoir naît du foisonnement, note Luc De Larminat, pour l’association Opale. Chacun ne détient pas l’unique manière dogmatique de faire. L’intérêt est d’avoir une vision systémique et archipélique. Comment on poursuit ensemble avec l’UFISC, le CRID, le CAC et les autres ? »
Une question que David Chassagne, coordinateur du collectif réunionnais Kolet’, traduit par « Comment et avec qui fait-on politique aujourd’hui, et notamment dans la perspective de 2027 ? Au moment où tout le monde se défie du politique, comment assumer le fait que les réflexions et actions de celleux qui composent POP MIND sont profondément politiques ? »
L’ombre portée d’une victoire de l’extrême-droite a été présente sur les débats, et Gilles Rouby, du CAC, veut y répondre en cessant de répondre aux injonctions du Rassemblement National : « Il faut dire ce qu’est une politique d’immigration qui nous enchante, plutôt que de subir simplement un discours sur l’accueil. Outre “Ouvrir les yeux, lever les poings, serrer les coudes”, ajoute-t-il, POP MIND est une occasion de muscler les cerveaux, parmi de multiples événements, encore trop organisés en silos entre luttes environnementales, collectifs de la culture, associations d’éducation populaire. » D’où une invitation à squatter mutuellement les événements des autres, et à travailler l’ouverture des silos au niveau local.
4.3. Assumer le sensible
Travailler ensemble suppose de nouveaux récits et du sensible : plusieurs participant·es soulignent l’importance de la place du sensible dans ce POP MIND, avec notamment les ateliers en acte des pertubationnistes menés par Gilbert Coqalane. Une participante invite d’ailleurs à joindre le geste à la parole et à se mettre debout pour amorcer les « premiers petits pas possibles » dans la salle !
« Ce sensible et cet imaginaire, peut-on le mettre à la racine ? » s’interroge Fabienne Quémeneur, qui travaille sur l’urbanisme culturel au sein de l’Agence nationale de Psychanalyse urbaine et du collectif Au bout du plongeoir. Elle cite à cet égard les rencontres Inter-mondes sur art et urbanisme et constate le besoin d’accorder les rythmes et temps de chacun·e dans la fabrique urbaine. « Dans les coopérations entre mondes différents, ça frotte, mais comment mettre l’art et la culture à la racine, faire en sorte que l’art ne soit plus ce qui vient au dernier moment couronner une réalisation imaginée et construite sans nous ? »
Dans l’exemple de la fabrique de la ville, elle constate que ce sont souvent des artistes – femmes – qui portent la question de la place des aîné·es, des enfants, comme la question décoloniale. « L’urbanisme culturel devient une rustine, il faut faire tenir un bateau et nous n’avons pas assez de bras dans l’intermonde ! Il faut un soutien politique à ceux qui essaient d’être tous ces endroits-là. Et les artistes pourraient être les forces d’embarquement de ces récits. »
4.4. Passer à l’offensive
Il revient à Laetitia Lafforgue, coprésidente de l’UFISC, de conclure ces trois jours de POP MIND vécus sous le signe de l’enthousiasme et dont elle se dit fière, après un travail considérable qui a vu une belle réponse tant des participant·es que des partenaires. « Ces rencontres nous ont montré que la convergence des luttes peut répondre à celle des crises ».
Quelles suites ? Le calendrier électoral est dans les têtes et marque l’urgence d’agir (précisons qu’au moment de POP MIND, un mois avant les élections européennes, l’imminence de nouvelles élections législatives n’existait pas encore). « Peut-être est-ce le moment, commente Laetitia Lafforgue, de faire émerger les UFISC régionaux, de se connecter entre nous, décalcifier la pensée, aller vers les voisin·es ? Nous avons souvent l’impression qu’il faut aller vers ce qui nous ressemble, peut-être est-il temps d’aller vers ce qui ne nous ressemble pas mais avec qui on peut converger. Il y a urgence et nous avons les outils : les droits, la fraternité, la sororité, l’économie à mettre à notre service, pour passer à l’offensive. Nos actions ringardisent déjà les idées d’extrême-droite : à nous de les radicaliser, dans la joie. »


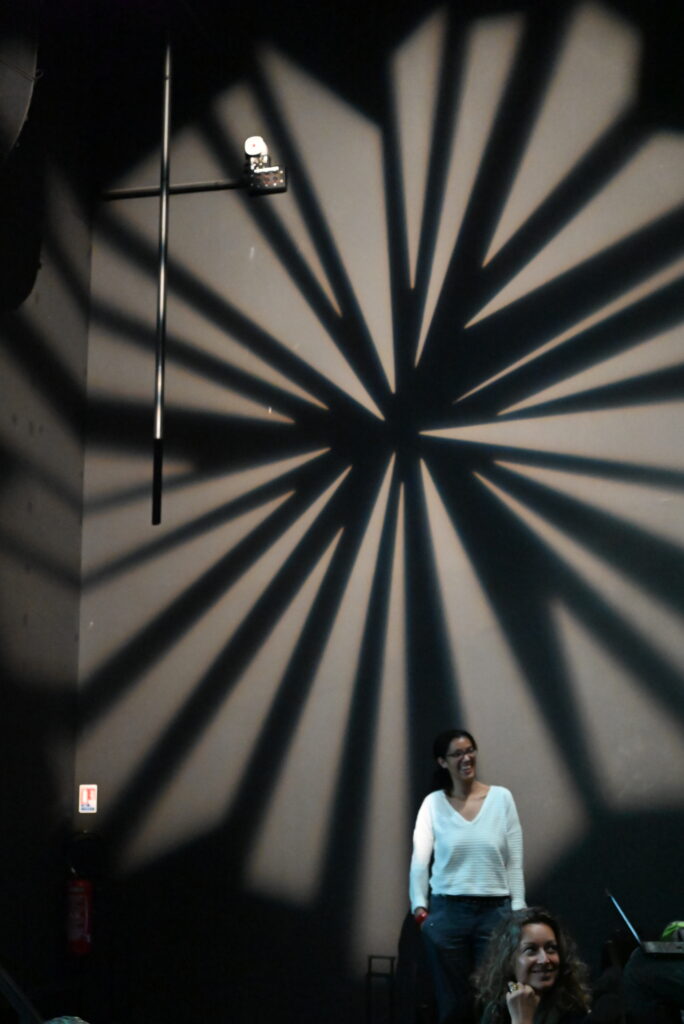

Cette synthèse a été rédigée par Valérie de Saint-Do pour l’UFISC.
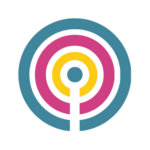
► Ressources
- Tribune « L’urgence d’agir en commun ! » par les organisateur·ices de POP MIND x Festisol parue dans Politis en avril 2024 : https://www.politis.fr/articles/2024/04/tribune-popmind-festivcal-des-solidarites-rennes-lurgence-dagir-en-commun/
- Plénière Environnement et droits des peuples, proposée par le CRID lors de POP MIND x Festisol, avec un focus autour des enjeux autour de l’eau. Pourquoi et comment renforcer la justice environnementale, dans une perspective de solidarité, du local au global ? A retrouver en vidéo.
- Pacte pour la transition : découvrir les 32 mesures concrètes pour construire des communes écologiques, solidaires et démocratiques.
- L’avis du CESE sur le financement des associations : “Renforcer le financement des associations : une urgence démocratique”.
- Déclaration de sortie de POP MIND 2021 : https://www.pop-mind.eu/wp#content/uploads/2021/11/POP-MIND-2021-DECLARATION-DE-SORTIE.pdf





