Les droits culturels sont inscrits depuis 1948 dans les droits humains fondamentaux. Les prendre en compte dans nos pratiques permet un regard renouvelé sur les personnes, leur dignité, leurs modes de vie et sur les relations qui les lient. Ils s’imbriquent aux luttes pour la diversité culturelle, l’intersectionnalité, les mouvements sociaux, la défense du vivant.
Comment les définir et saisir ensemble, comment peuvent-ils constituer une boîte à outils de résistances et alternatives, notamment artistiques et solidaires ? Tel était le pitch de l’atelier animé conjointement par Loane Oger, chargée de mission à Horizons solidaires et Audrey Vicenzi, chargée de projet ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) à Gescod, réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationales – Grand Est.
Animation
- Loane OGER, Chargée de mission à Horizons solidaires
- Audrey VICENZI, Chargée de projet ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) à Gescod, réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationales – Grand Est
Intervenant·es
- Jean-Pierre CHRÉTIEN-GONI, Metteur en scène, Anthropologue, Directeur à Le Vent se lève ! Zone libre d’art et de culture éthique et solidaire
- Cécile OFFROY, Sociologue, Maîtresse de conférences associée à l’Université Sorbonne Paris Nord, Chargée d’études à Opale-CRDLA Culture
SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)
L’UFISC a placé les droits culturels au cœur de ses recherches et actions depuis une dizaine d’années. La singularité des ateliers proposés cette année à POP MIND était de travailler avec les coorganisateur·ices de l’événement et notamment le Festival des Solidarités, pour proposer d’autres angles d’approche de ces droits, que l’épithète « culturels » ne cantonne pas au seul monde des professionnels de la culture, loin de là.
Cet atelier sur les droits culturels était ainsi inscrit dans un parcours plus global autour des droits culturels1 mis en lecture des dimensions de la santé, de l’alimentation et du travail ainsi que par un atelier conclusif sur l’accompagnement et la formation.
L’UFISC et les coordinateur·ices de ce parcours2 avaient invité pour cet atelier introductif deux intervenant·es : Jean-Pierre Chrétien-Goni, metteur en scène, anthropologue, directeur à Le Vent se lève ! Zone libre d’art et de culture éthique et solidaire, et Cécile Offroy, sociologue, maîtresse de conférences associée à l’Université Sorbonne Paris Nord, chargée d’études à Opale-CRDLA Culture.
Des définitions « prescriptives » ?

L’exercice incontournable, dès que l’on travaille collectivement sur les droits culturels, est celui de la définition. En ouverture de l’atelier, les animatrices ont choisi la formule « boule de neige », qui voit les participant·es se mettre par groupes de deux, puis quatre, pour trouver des définitions si possibles consensuelles.
Le premier groupe livre sa définition en trois points :
- Droit de chacun·e à posséder une culture propre, au sens large, composante de son identité individuelle et collective, (expressions régionales, cuisine, etc), à se l’approprier, à la revendiquer, à avoir des espaces pour l’exprimer et la partager.
- Droit à avoir un accès effectif aux autres cultures, considérées comme toutes également valables.
- Capacité à faire humanité ensemble en limitant les rapports de domination et en conscience de sa part de responsabilité.
Pour le second groupe, seul le droit « d’exprimer leur humanité pour les personnes » fait consensus. Un participant exprime en effet sa défiance pour une définition se voulant universelle : « beaucoup de gens, dans différents pays ont un rapport aux autres et au vivant qui n’est pas exprimé dans un langage juridique et normatif, ni défini par un anthropologue. Qu’est-ce qu’on appelle la cuisine, par exemple ? J’ai une réserve vis-à-vis de l’approche anthropologique, je préfère l’approche éthique qui veut que l’on soit capable de discuter d’une manière digne avec toutes et tous parce qu’on respecte l’humanité de l’autre. » Il cite à cet égard le texte de Christoph Eberhard Au-delà d’une anthropologie des droits de l’homme : Les horizons du dialogue interculturel et du royaume de Shambhala ? qui analyse les difficultés posées par le langage juridique des droits humains dans les relations internationales.

Un autre participant souhaite également envisager aussi les droits culturels comme un espace de mise en pratique, pour gagner en efficience des droits culturels : « en tant qu’acteurs de terrain, nous souhaiterions définir un cadre opératoire ouvert et une méthodologie ».
Pour le dernier groupe, quatre éléments de définition des droits culturels font consensus :
- Droit humain fondamental de prendre part à la vie en société.
- Outil-balise d’éthique pour la considération des personnes dans une humanité commune.
- Possibilité d’exprimer et de choisir son identité et ses références culturelles, de les faire évoluer dans une diversité de récits.
- Libertés et responsabilités individuelles et collectives qui s’exercent dans la rencontre et le respect des altérités.
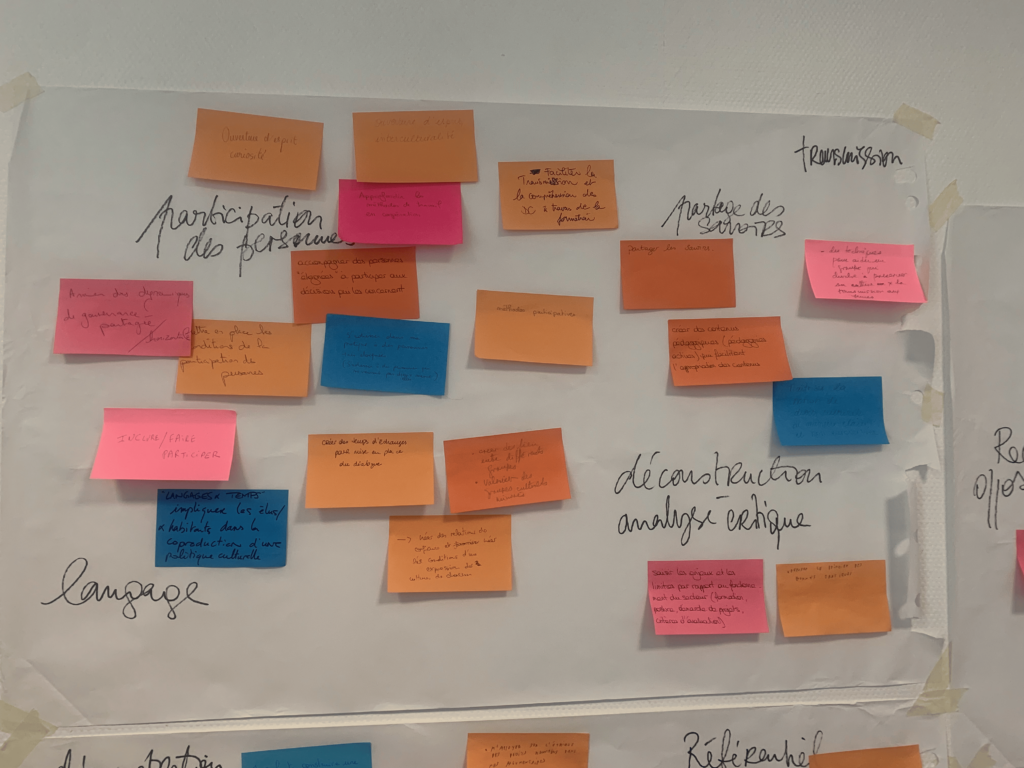
Inscrits sur un tableau, les mots-clefs de ces différentes définitions prêtent toujours à débat : « Certains mots sont très prescriptifs et presque bien-pensants. On y perçoit pas de tensions… Or, les droits culturels c’est bien plus qu’une boîte à outils !, remarque Cécile Offroy. Or il s’agit bien d’une éthique de la relation qui confronte un certain nombre de principes et de valeurs aux pratiques. C’est dans cet écart que se pose la question des dominations : les droits culturels sont révélateurs d’un certain nombre de rapports sociaux. D’autre part, ajoute-t-elle, que signifie Faire humanité ensemble ? est-on dans l’utopie pacifique d’une permaculture humaine ? ».
Les droits culturels en situation… et en tension
Le risque, c’est l’irénisme3, appuie Jean-Pierre Chrétien-Goni qui rappelle qu’humanités se décline au passage dans la pensée d’Édouard Glissant4 notamment. Comment les droits culturels se déclinent-ils hors du débat universitaire, en situation difficile ?
Il livre à cet égard son expérience : « Je travaille avec des personnes en situation de handicap, parfois très lourd ; faire humanité commune me met dans de sacrées interrogations au quotidien. Comment entretenir un espace de relations dignes de ce nom avec quelqu’un qui n’a pas la parole ou ne sait pas ce qu’il a dit cinq minutes avant ? Dans le concret, toutes les relations deviennent extrêmement pointues. Il y a des expériences qui mettent les valeurs que vous avez évoquées à l’épreuve.
À Fleury-Mérogis, je mène un atelier avec des détenus. Cette année, plutôt que de répondre à une commande thématique, j’ai précisément voulu partir des droits culturels en laissant les participants de l’atelier faire leur choix : “Qu’est-ce que voulez ? Moi je n’ai pas de sujet, mais vous savez qu’on peut faire du théâtre ensemble.”
On commence à réfléchir, à faire quelques jeux ; ça se passe le 21 octobre. Là, l’un des participants demande à me parler, et me dit “si on continue à jouer comme ça, je m’en vais”. “Pourquoi ?” “Parce que j’ai le cœur qui saigne”. “Ok, on en parle”. Il explique pourquoi son cœur saigne. D’autres saignent probablement autour de lui. On se demande comment travailler avec ce sentiment. Il propose un sujet : « l’altération ». La fois suivante, il vient avec un texte de dénonciation de notre société, d’une violence inouïe, dans lequel on sent tout le souffle du salafisme. C’est assez bien écrit, et c’est posé sur la table, comme ça. Et on a démarré le travail avec.
Les droits culturels sont précisément liés à ces moments-là, où les questions qui nous sont posées sont extrêmement concrètes. Que dois-je répondre ? “Ah non, ce n’est pas un texte républicain” ? Ou essayer de l’endormir ? Son texte brut est juste scandaleux : il dit que notre société est « incestueuse ». Comment est-ce que je me débats avec ça, en étant celui qui dit “les humanités s’expriment”, et laisser passer avec mes propres convictions et ma dignité, qui se dit “je vais laisser passer ça” ? Est-ce que je l’enturlupine, ce qui serait facile, en tentant d’adoucir les propos ? ».
« Ce brut-là est un brut de rencontres qui n’est pas unique, ajoute Jean-Pierre Chrétien-Goni, il y a des espaces de haute tension. Et les droits culturels sont là où on laisse apparaître toutes les tensions possibles. Ce n’est pas confortable, mais sinon on tombe dans le “qu’est-ce qu’on est des gens bien !” On écoute l’autre, mais l’autre m’emmerde, dit des conneries ! Qu’est-ce qu’on fait avec un groupe d’habitants d’où n’émerge qu’un discours d’extrême droite ? On a la figure du “joli étranger” : il faut voir le nombre “de cuisines du monde” dans les quartiers, on est aux limites du folklore.
Mais il faut à la fois tenir notre discours et s’interroger : qu’est-ce qu’un droit ? Est-ce un droit opposable ? Quel tribunal pour des droits culturels qui n’ont pas été respectés ? Où est-ce une autre forme de droit ? Il y a un certain nombre de droits auxquels nous ne pensons pas parce que nous n’en sommes pas privés. Je ne suis privé nulle part du droit de parler ma langue. Ma mère, d’origine espagnole, en a été privée : son père le lui a interdit. J’ai fait un atelier avec des ouvriers iraniens qui me répondaient : “Les droits culturels ? Mais chez nous, il n’y a même pas les autres droits !”. On ne peut pas faire comme si ce n’était pas le cas. Qu’est-ce qui est le plus important ? Qu’est-ce qui fait priorité dans le travail des gens là où ils sont, du point de vue des leurs situations ? On a besoin de toutes les définitions qu’on se donne, mais en même temps il faut les mettre à l’épreuve qui n’est pas si rare que ça. ».
« La fin de l’histoire de ce texte, conclut Jean-Pierre, c’est que j’ai répondu à son texte et que c’est devenu un dialogue écrit. Mais le jeu n’est pas forcément équitable : j’ai l’habitude d’écrire. Et j’ai déjà vécu une expérience similaire, avec un début de livre et un projet de publication, mais pour lequel je ne suis pas allé jusqu’au bout. Là, nous sommes au milieu de l’expérience… ».
L’universel interrogé
L’intensité de l’expérience provoque de multiples réactions.
« Comment arriver armé face ce genre de situations ? se demande un participant. Cela oblige à faire la différence entre une éthique publique et la morale personnelle. Est-ce que je poursuis ce dialogue pour entretenir tous les espaces d’humanité qui restent, coûte que coûte, ou est-ce que je me trouve à faire inhumanité avec quelqu’un d’autre, à rejoindre un courant d’inhumanité qui fait qu’une femme ne pourrait pas nous rejoindre dans la discussion ? Dans certaines situations, cela devient intolérable et c’est pourtant là où il faut être. Ne jamais arrêter de parler. Parce que si un grain d’humanité s’exprime, c’est parce qu’on aura gardé le contact. »

« Ce que cela m’évoque, commente un autre, c‘est la question de la différence et celle de la relation. On pourrait penser que la différence, c’est ce qui nous sépare ; l’approche par les droits culturels nous permet de penser que la différence est ce qui nous permet de faire ensemble, de construire la relation. Peut-on entrer en relation avec quelqu’un dont on ne partage pas les points de vue ? Mais peut-on débattre de tout, à égalité, sur tous les sujets, à l’instar des chaînes d’extrême droite qui mettent sur le même plan un scientifique et un climato-dénialiste ? En tout cas, dans nos démarches, s’approprier les différences comme quelque chose avec quoi on peut fabriquer de la relation, je trouve ça essentiel. »
Pour une participante, cela pose la question de l’universalité des droits culturels et des droits humains, qui ne va pas de soi et crée un débat des participant·es : « en Inde, tu nais dans une caste et tu y restes ? Donc, faire humanité, est-ce juste avec ceux pour qui les droits de l’Homme sont reconnus ? ».
« C’est un combat, répond un autre. Mais l’avantage est que dans les relations internationales, ceux qui sont en désaccord avec ce modèle n’osent pas proposer un autre modèle. C’est un choix politique de valeurs. »
L’intervention de Jean-Pierre Chrétien-Goni a posé en tout cas un exemple concret de mise en œuvre des droits culturels, et fait écho à d’autres expériences rencontrées. Pour plusieurs participant·es, cela illustre la question de l’intitulé à laquelle ils attendent une réponse : comment créer et résister avec les droits culturels ? « Les personnes dans la pratique se rendent bien compte des difficultés. Il y a des choses qui nous permettent de tenir bon, donner du sens à ce qu’on fait, faire le mieux possible. » conclut une participante.
Le dialogue suffit-il ?
Cécile Offroy offre un nouveau sujet de débat : « On a mis l’accent sur la mise en dialogue. Mais est-ce que la mise en œuvre des droits culturels s’arrêtent là ? Derrière cette injonction, se pose la question politique de la visibilité d’un certain nombre de récits qui sont absents ou invisibilisés dans nos sociétés. Par exemple, quid de la place des femmes ou des pratiques considérées comme féminines dans les musées ? Les droits culturels nous emmènent plus loin que la question du dialogue.

En Belgique, l’agrément des centres culturels est lié à leur capacité de mettre en œuvre les droits culturels. Forcément, les pratiques en sont transformées. L’association Periferia, par exemple, cherche à réduire les inégalités au sein de la société, avec une attention plus particulière à ceux qui ont moins de facilité à prendre part aux débats publics, souvent parce qu’ils vivent des situations difficiles. Comment se parler d’être à être à partir de nos vulnérabilités ? Tout ce que nous nous sommes dit sur les droits culturels pourrait par exemple concerner la question de la santé, tout aussi transversale que celle de la culture. Cela pose la question des lieux de porosité entre les différentes dimensions des droits humains. »
Résister, créer, traduire
Jean-Pierre Chrétien Goni insiste sur cette notion de porosité : « La capacité de résistance et création liée aux droits culturels ne concerne pas seulement la création artistique mais le pouvoir de transformation. Les droits culturels sont un concept, pas une boîte à outils, on souhaite aussi leur donner une efficience. Des pratiques se mettent à l’œuvre où l’on invente et l’on crée, autour de la pédagogie des droits culturels, des recherches-actions… Il faut réfléchir aussi à leurs limites. Notre vrai boulot, c’est traduire, constamment traduire, dans un monde précis. »
Il livre en conclusion quelques-unes de ses « traductions » :
- Les droits culturels, c’est « ne pas savoir à la place de l’autre » quand on est artiste, sociologue, acteur social. « C’est compliqué, parce que parfois on est payé pour ça, et qu’on nous le demande, comme on exige de nous d’être « dans la bonne distance » » ;
- C’est aussi un principe révolutionnaire : le principe de l’égalité radicale des intelligences. « Si vous l’appliquez vraiment, concrètement, autour de vous, c’est une hypothèse éthique qui change absolument tout » ;
- C’est une invitation à aller chercher les absents. Les inviter, ou savoir pourquoi ils ne sont pas là ;
- Enfin, c’est une exigence d’ouverture des espaces de création, d’invention. À cet égard, Il ne mâche pas ses mots : « J’essaie d’ouvrir des manufactures d’art dans les EHPAD. Je n’interviens pas, je veux habiter et travailler avec les gens ! Les artistes « intervenants », ça me sort par les yeux ! Tout est possible à mobiliser dans ces espaces, donc on y vient sans projet ! »

Une participante conclut en évoquant à titre d’exemple l’histoire du BAM – Bâtiment à Modeler, lieu où est accueilli l’atelier : un espace de résistance et de quartier où se tenait la bibliothèque, regrettant que ce bâtiment occupé par de nombreuses associations utiles à la vie du quartier soit voué à la destruction.
« La question, conclut Cécile Offroy, est aussi celle de la place, physique et mentale : celle que prennent les personnes, et la capacité à précisément leur laisser la place. ».
- Les ateliers du parcours « Droits culturels et diversité culturelle », proposé en plus de celui-ci (« Pour mieux faire solidarité, résister et créer avec les droits culturels ! « ) : « Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ? » / « Accompagner et former aux droits culturels : quels besoins ? Quelles expériences ? » / « Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ? « ). ↩︎
- UFISC, Réseau Culture 21, OPC, Opale-CRDLA Culture, Gescod, Horizons solidaires. ↩︎
- Attitude visant à la compréhension mutuelle en se focalisant sur ce qui unit ou rapproche et en minimisant ce qui éloigne ou amène au conflit. Par extension, c’est un peu devenu synonyme de « bons sentiments » ou croyance naïve à la disparition des conflits. ↩︎
- Écrivain français, à l’origine notamment des concepts de créolisation et la relation. ↩︎




Ressources
Ressources en lien avec les interventions et thématiques abordées dans cet atelier
| Les droits culturels, une boussole pour travailler auprès des « outsiders », | Podcast avec Jean-Pierre Chrétien-Goni. Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Culture·Co et l’Observatoire des politiques culturelles, à l’occasion de la Rencontre nationale des départements pour la culture, les 30 novembre et 1er décembre 2023. |
| “Les droits culturels interrogent les rapports de domination culturelle, économique, symbolique et sociale” | Entretien avec Cécile Offroy réalisé dans le cadre des rencontres POP MIND 2021 par Profession Spectacle. |
| Pratique d’un art « situé » et « relationnel » | Tribune de Jean-Pierre Chrétien-Goni. 3ème Rencontre nationale des départements pour la culture, organisée par Culture.Co. |
| Les droits culturels : un nouveau référentiel pour les Centres culturels ? | Une étude de Céline Romainville sur les droits culturels, et notamment le droit de participer à la vie culturelle, et l’impact d’une référence à ces droits dans le décret sur les centre Culturels en Belgique comme exemplification. |
Explorer le référentiel des droits culturels
| Les droits culturels, c’est quoi ? | Diaporama proposé par l’OPC. |
| Les droits culturels dans la Déclaration de Fribourg | Carnet de traduction réalisé par Réseau culture 21. |
| Démocratisation, démocratie et droits culturels | Rapport d’étude de Réjane Sourisseau et Cécile Offroy. Réalisation Opale pour la Fondation Carasso, 2019. |
| Padlet de l’UFISC sur les droits culturels | Textes de référence et ressources thématiques. |
| Typologies. Les droits culturels en action. | 10 typologies d’action pour mettre en effectivité les droits culturels, issues des travaux réalisés dans le cadre de la démarche Paideia menée par l’association Réseau culture 21 et l’Observatoire de la diversité et des droits culturels. |
| « Cartographie des droits culturels : nature, enjeux et défis » | Page ressources du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. |
| Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) | Droits culturels et patrimoine. |
| ESS et Droits culturels. Pour une économie attentive aux relatives d’humnité dans un monde vivant. | Synthèse des travaux réalisés par le groupe de travail ESS & Droits culturels du Laboratoire de transition vers les droits culturels. |
Ressources issues de la recherche-action Pour une démarche de progrès par les droits culturels, initiée et coordonnée par l’UFISC
| Culture, communs et solidarité : cheminer avec les droits culturels | Publication sur le cheminement de l’UFISC et de ses membres vers les droits culturels, 2017. |
| Les droits culturels, de la parole aux actes. | Cycle de rencontres et de webinaires proposé par les agences Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre, en partenariat avec l’UFISC. |
| Chemins Faisant | Podcast en 10 épisodes, qui propose de partir à la rencontre d’actrices et d’acteurs culturels, pour qui les droits culturels, ce ne sont pas juste des mots. |
| Droits culturels – les comprendre, les mettre en œuvre. | Ouvrage collectif, co-édition Editions de l’Attribut, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et UFISC. |
► Mise en perspective POP MIND 2019 « Les droits fondamentaux : une zone à défendre et à renforcer en France et en Europe ! »
- Comment mettre en travail les droits culturels ?, table ronde à podcaster.
Avec ANAÏS MASSOLA, Libraire (Le Rideau Rouge), administratrice d’AILF (Association Internationale des libraires francophones) et membre du directoire de SLF (syndicat de la librairie française) ; ANNE-CHRISTINE MICHEU, Chargée de mission sur les droits culturels au ministère de la Culture ; CHRISTIAN RUBY, Philosophe, docteur en philosophie ; MARTA SILVA, Fondatrice et directrice artistique et exécutive du projet LARGO Résidências (Lisbonne) ; SUSANA SOUSA, Directrice des services de la GEPAC, Direction des Services de stratégie, programmation et évaluation culturelle (Portugal).
- Palabre autour des droits culturels, temps d’échange libre à podcaster.
En lien…
-
Culture et ruralité : après le printemps, voilà l’été ?
En quinze ans de labourages et pâturages aux quatre coins du pays, l’équipe de l’UFISC a rencontré et recensé une myriade de projets… Cette exploration du terrain a conduit à des constats déclinés en introduction de cette table ronde par Grégoire Pateau et Alban Cogrel, avant que les invité⸱es, praticien⸱nes de terrain puis élu⸱es, ne…
-
Itinérances artistiques en territoire : coconstruire entre compagnies, lieux et collectivités (audio)
Les États Généraux des Itinérances Artistiques (EGIA) étaient à POP MIND pour organiser un temps de recherche autour de l’itinérance et des territoires ruraux. Quelles sont les capacités d’accueil à la fois du point de vue des villes, des compagnies et des institutions pour des projets itinérants ? Ce temps de travail a rassemblé, autour…
-
Territoires ruraux et jeunesse : agitons la culture !
De nombreuses initiatives artistiques, culturelles, associatives en France et en Europe encore trop discrètes ont des démarches diverses qui permettent de repenser comment on habite un territoire, les relations entre personnes, l’accompagnement des initiatives de jeunes adultes, dans une logique de coopération, de réseau, de formes de solidarité et de mutualisation.



