Deux ateliers successifs se sont penchés sur les dangers qui menacent – voire entravent effectivement – les libertés associatives.
Le premier, le 13 mai, plantait le décor, avec un point de situation global, et esquissait des pistes de solution.
Le deuxième s’est plus spécifiquement penché sur le contenu et les incidences du Contrat d’engagement républicain (CER) imposé à toutes les associations demandant des soutiens publics, et à ses incidences notamment pour les associations militantes et le droit à la désobéissance civile.
Intervenant·es
- Jean-Baptiste JOBARD, Coordinateur de l’Observatoire des Libertés Associatives, Délégué général du Collectif des Associations Citoyennes (CAC).
- Emma MARC, Chargée de mission au Collectif des Associations Citoyennes (CAC), sur la démarche Droit et Mouvements Sociaux (DMS)
- Xavier MILLINER, Coordinateur de CORLAB, coordination des radios locales et associatives de Bretagne
SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)
L’atelier s’était donné pour ordre du jour un état des lieux sur l’impact du Contrat d’engagement républicain sur les associations en Bretagne, avant d’en venir au détail de ce contrat et aux modes de résistances face à son impact négatif sur les libertés associatives.
En introduction, Jean-Baptiste Jobard, coordinateur de l’Observatoire des Libertés Associatives et délégué général du Collectif des Associations Citoyennes a proposé un tour de table autour de deux questions :
- Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre connaissance du contrat d’engagement républicain ?
- Toujours sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous les dangers qu’il fait peser sur les associations ?
À la première question, les participant·es – responsables d’associations culturelles ou engagé·es sur le champ social, de structures ou d’agences culturelles – montrent une connaissance du contrat dans la moyenne, avec une note autour de 5 : il est connu au moins par son nom, mais rarement en détail.
En revanche, ses dangers sont ressentis par les participant·es et évalués entre 8 et 10 sur l’échelle proposée. Il est perçu comme un moyen de contrôle, ceci d’autant plus qu’il fait l’objet de peu d’informations ou d’avertissements quant au danger de son non-respect supposé. Les représentant·es de radios indépendantes y sont particulièrement sensibles, ayant été en première ligne des avertissements, voire des sanctions quant à son respect.
C’est ce que détaille Xavier Milliner, coordinateur de CORLAB, Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, dans son intervention.
Quand le couperet tombe sur la liberté d’information
La CORLAB (Coordination des radios locales et associatives de Bretagne) s’est emparée de la question du Contrat républicain dès février 2023, avec une table ronde organisée dans le cadre du festival Longueur d’ondes à Brest :
« Des exemples avaient fait l’actualité, explique Xavier Milliner, à Poitiers, Alternatiba avait vu ses subventions votées par la mairie mais retoquées par le préfet. La Clef des Ondes à Bordeaux était houspillée par la préfecture pour sa couverture du mouvement des Gilets jaunes, et des élus s’en prenaient à Radio Kreiz Breizh en raison des reportages de Morgan Large – qui a fait l’objet de menaces et même de sabotage de sa voiture – pour sa couverture des dégâts de l’agro-industrie, dont la notoriété dépasse largement la Région Bretagne.
Nous sommes sorti·es de cette table ronde en nous demandant : “Quand est-ce que ça va nous arriver ?”. Dans le cadre des activités ordinaires d’une radio, on donne le micro chaque semaine à des associations militantes qui organisent des luttes. Étant donné que le contrat stipule : “ne pas créer de troubles à l’ordre public”, on sentait qu’on pouvait très vite être hors des clous en tendant le micro à ceux qui revendiquent des formes de désobéissance civile.
Déjà, bien en amont du CER, Radio Kreiz Breizh avait vu ses subventions coupées par plusieurs mairies suite aux reportages dérangeants de Morgan Large et Inès Léraud. Le cas de RKB est emblématique : Morgan Large s’inquiétait du risque que faisait courir son travail à la radio au cas d’un procès bâillon et s’est parfois autocensurée.
Les exemples sont très courants dans les radios : quel est notre degré d’irrévérence quand on demande une subvention à une ville ou une métropole chaque année ? On est dans une relation asymétrique avec une liberté éditoriale un peu entravée.
Les radios sont aussi très présentes dans l’éducation aux médias. Dans ce cadre, l’un des animateurs avait proposé de travailler sur les valeurs de l’olympisme. Les adolescent·es préféraient interroger les coûts économiques et environnementaux des Jeux. Ils ont produit un podcast de 30 minutes et un responsable de la mairie a demandé de ne pas diffuser le sujet, parce que la mairie avait envie que le territoire s’enthousiasme sur les jeux. Les libertés associatives et pédagogiques sont menacées. Ce sont des exemples qu’on essaie de contourner avec un peu de malice pour rester les porte-voix d’une certaine radicalité. »
Xavier Milliner avait trouvé des allié·es au sein des fonctionnaires de la préfecture, qui, au printemps 2023, se voulaient rassurant·es. Mais le couperet est tombé avec le cas du lieu alternatif L’Avenir qui a concerné quatre associations dont une radio adhérente.
L’Avenir était un squat culturel autogéré porté par un collectif, dans le quartier brestois de la place Guérin que Xavier Milliner qualifie de “interlope-festif-militant”. Le projet de L’Avenir s’opposait notamment à un enjeu de prédation immobilière sur ce quartier. Différentes associations brestoises l’ont soutenu : le patronage laïque Guérin, une télévision participative, Ékoumène, et enfin Radio U, la radio universitaire brestoise.
Ces quatre associations ont fait des demandes de subventions dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative (FDVA), et ont appris que leurs demandes étaient retoquées. « Au début, commente Xavier Milliner, la radio ne s’en inquiète pas : elle avait été soutenue l’année précédente. Mais on a appris que le procédé de non attribution était obscur : les associations s’étaient vu attribuer une subvention a priori, mais il y a eu intervention du sous-préfet de Brest pour la supprimer en mode sanction. On a très vite su que la question du soutien à L’Avenir était au cœur de l’intervention du préfet, avec pour seul reproche le fait d’avoir participé à des manifestations en soutien au collectif, et pour la radio, le fait que ses membres y aient été vus ! Cela a été relayé dans la presse, obligeant le sous-préfet à se justifier. Les associations ont engagé la riposte qui n’est pas évidente : une nouvelle tribune a été proposée et relayée. Le sous-préfet assume sa décision avec l’argumentaire : “Si les associations se positionnent contre l’État, qu’elles ne viennent pas réclamer de subventions”. C’était curieux pour le cas de Radio U, comme pour le Patronage laïque, qui se voyait reprocher de salarier telle personne membre du collectif l’Avenir ».
Xavier Milliner précise que certain·es élu·es ont soutenu la tribune en faveur de l’Avenir et que la Ville de Brest a réaffirmé son soutien à Radio U.
Le CER : superfétatoire et anodin à première vue…
Les cas bretons ayant planté le décor , c’est au tour de Jean-Baptiste Jobard de préciser le contenu du Contrat d’engagement républicain et de présenter le travail de l’Observatoire des libertés associatives.
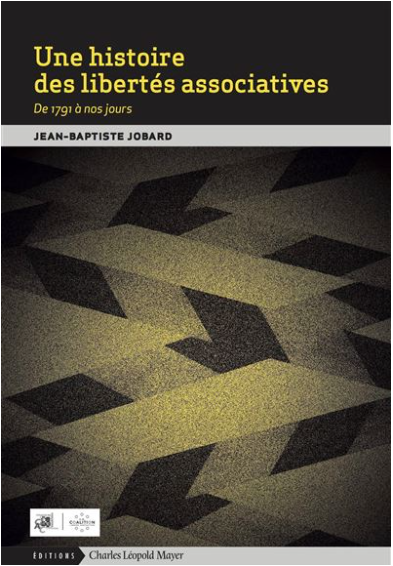
C’est notamment dans ce cadre que le Collectif des Associations Citoyennes (CAC) s’est lancé dans un travail d’explicitation de ce nouveau cadre légal auprès des associations mais aussi auprès élu·es locaux·les, démuni·es depuis la sortie des décrets d’applications le 1er janvier 2022.
« Le CER, précise-t-il, est un décret d’application de la loi dite “séparatisme”. Il s’est écoulé six mois entre le vote de la loi et la sortie du décret. C’est un texte de longue portée : il y a 1,3 millions d’associations en France, et 22 millions de bénévoles, usagers, adhérents. Or, l’obtention de moyens est désormais conditionnée à la signature de ce contrat, quelle que soit l’aide sollicitée, financière ou prêts de salle et de matériel. C’est aussi le cas pour tous les types d’agrément. Quand le contrat a été évoqué dans la loi, le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) a dit que le texte était superfétatoire, inutile, puisque les pouvoirs publics disposent de tous les leviers nécessaires au contrôle, aux sanctions et à la dissolution des associations. (Article 3 de la loi de 1901) ».
« La deuxième caractéristique de ce texte est l’ambiguïté et l’arbitraire. Le CER est un article dont on ne connaissait pas la teneur, d’une loi très fourre-tout, qui comporte 104 articles dont 6 seulement concernent le monde associatif. Ce qui explique que l’on ait du mal à réagir.
Le texte peut apparaître anodin à première lecture. Le CER renvoie à sept engagements qui enfoncent des portes ouvertes : respect des lois de la République, liberté de conscience, liberté des membres de l’association, égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine, respect des symboles de la République. Qui pourrait être contre ? C’est déjà dans la loi ! Là où le processus liberticide est très fourbe, c’est dans les détails rédactionnels, notamment autour de deux notions, celle d’ordre public et d’incitation.
L’ordre public n’a pas de définition juridique stricte. Qui considère que l’ordre public est troublé ? commente Jean-Baptiste Jobard. L’autre notion clef, c’est la notion d’inciter. On n’est pas seulement dans l’observation factuelle de faits réprimandables, mais dans l’intentionnalité – ce qui est un registre effrayant ».
… mais une pièce de l’engrenage autoritariste
« En fait, analyse Jean-Baptiste Jobard, le CER est un recul de l’État de droit : une extension des pouvoirs administratifs qui viennent supplanter l’autorité judiciaire. Là où les procédures judiciaires offrent des garanties de recours et défense, on ne les a plus. Il s’agit de sanctions non suspensives, comme de devoir rembourser une subvention, ce qui peut être équivalent à une mise à mort. Si une association de protection de l’environnement s’oppose à une construction, il suffit que le maire déclare qu’elle contrevient au contrat d’engagement républicain pour que toutes ses subventions tombent ! ».
Le CER confère à l’administration des pouvoirs très larges, sans intervention claire sur les recours possibles pour les associations et les fondations mises en cause. Car le texte concerne aussi les fondations, mais pas les entreprises qui touchent trois fois plus de subventions que les associations en France…
Que vaut un contrat signé avec ce degré de menace ? L’article 5 du décret précise de surcroît que “sont imputables à l’association les manquements faits par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles, ainsi que tout manquement commis par eux et directement lié aux activités de l’association, dès lors que ses organes dirigeants bien informés de ces agissements se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser compte tenu des moyens dont ils disposaient.” Ce qui ouvre la porte à un pouvoir de police interne des associations.
Jean-Baptiste Jobard ajoute à cette analyse ce qu’il appelle « une parenthèse de philosophie politique » : « Michel Foucault évoquait dans Surveiller et punir la “sobriété punitive” en lien avec la construction d’une société disciplinaire et du panoptique : le pouvoir n’est plus seulement centralisé et localisable, il devient diffus et opère en réseau sous la forme de micro-pouvoirs qui passent par les corps et l’auto surveillance. Tout se passe comme si, chacun se sentant surveillé, devenait surveillant à son tour. C’est cela, l’esprit du CER. C’est un contrat non seulement inutile, mais contre-productif. Il a été mis en place après l’assassinat de Samuel Paty dans l’idée de lutter contre le terrorisme islamiste. Mais il n’existe aucune étude sur l’entrisme islamiste dans les associations ! On loupe la cible et on atteint tout le monde associatif. En revanche ça s’applique aux associations écologistes et de défense des étrangers. Ça crée une chape de plomb au lieu de libérer les énergies associatives et citoyennes. »
Depuis le 1er janvier 2022 et la mise en place de ce contrat, les cas où l’on va jusqu’au bout de procédures juridiques pour sanctionner une association sont extrêmement minoritaires. Et pour deux d’entre eux, ils ont été retoqués par les tribunaux : le Planning familial en Saône-et-Loire, pour une affiche avec une silhouette de femme voilée, et Alternatiba à Poitiers. Le cas brestois ou de Poitiers sont minoritaires. La plupart du temps, le CER est utilisé pour faire peur, off the record, par intimidations, menaces, pressions des préfets.
« Cela ressemble à une boîte noire, conclut Xavier Milliner. Le préfet ne mobilise pas le CER, il a bien vu que des associations avaient gagné. C’est un totem brandi, mais ça permet le bluff. ».
Quelles ripostes par le droit ?

Emma Marc forme les associations à se saisir du droit face à un cadre légal très flou. La loi, estime-t-elle, ne répond pas à l’exigence de clarté et lisibilité. Les notions de laïcité, de civisme et de valeurs de la République ne sont pas définies. Cela suscite des interprétations problématiques par les préfets qui leur permet d’attribuer ou refuser les subventions de manière arbitraire. Il suffit parfois de soutenir une association qui fait de la désobéissance civile sans participer à son action pour être accusé de contrevenir au CER.
Deux affaires jugées, le refus par le préfet d’une subvention votée à Alternatiba par la mairie de Poitiers et la volonté de dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre par le ministère de l’Intérieur ont permis des apports juridictionnels.
« Dans l’affaire Alternatiba Poitiers, explique Emma Marc, on a vu le premier recours contre l’article 12 de la loi qui permet à une autorité administrative de retirer une subvention à une association quand son objet ou ses modalités d’action sont illicites ou incompatibles avec le CER. Il était reproché à Alternatiba d’organiser une formation à la désobéissance civile. Ce qui montre l’enjeu du CER : lutter, précisément, contre la désobéissance civile. ».
Dans cette affaire, le tribunal administratif a estimé que la formation à la désobéissance civile ne constituait pas des actions incitant à la violence et occasionnant du trouble à l’ordre public. Il a également jugé que cette action ne constituait pas en elle-même un trouble à l’ordre public puisque les actions étaient pacifiques et non violentes.
« Avec ces deux critères cumulatifs, le jugement de Poitiers constitue une victoire juridique, estime Emma Marc : le juge a requalifié “l’incompatibilité avec le CER” et reconnu un droit à la désobéissance civile dans le cadre du CER. »
Elle ajoute que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) reconnaît les associations comme « chiens de garde de la démocratie« , d’où l’importance de légitimer la notion de désobéissance civile.
Emma Marc travaille précisément sur la définition de la désobéissance civile avec Marion Ogier, avocate et membre du Comité national de la Ligue des droits de l’Homme, pour répondre à ses détracteurs qui l’accusent de légitimer la violence. Cette définition comporte six composantes dont deux majoritaires :
- Agir au nom de principes supérieurs (ce qui reste aussi ambigu et équivoques que les « valeurs de la République ».
- Agir de façon non violente.
« L’objet de la désobéissance civile, précise Emma Marc, c’est d’être un ultime recours pour modifier spécifiquement une loi, puisque le but est d’aller devant la justice pour changer la loi. C’est vraiment un enjeu démocratique : cela permet d’interroger la légitimité de la loi et d’orienter les décisions gouvernementales vers l’intérêt général. »
Devant le juge, quels droits peut-on faire reconnaître ? « Il n’y a pas de principe constitutionnel qui consacre la désobéissance civile, mais il existe en revanche un principe de libre administration des collectivités territoriales qui permet aux collectivités de financer qui elles veulent sans être retoquées, précise Emma Marc. De plus, les citoyens disposent de droits fondamentaux à s’organiser et à manifester et le CER doit respecter ces libertés fondamentalement reconnues, mais aussi reconnaître des éléments contextuels exceptionnels moins connus, comme l’état de nécessité. Ce sont ces deux formes qui permettent de décriminaliser la désobéissance civile : liberté d’expression et état de nécessité. C’est important de le faire valoir devant la justice, parce que la justice permet à la fois de conserver, mais aussi de créer des droits : le contexte stratégique a son importance. C’est également important de saisir aussi la justice européenne : l’article 12 de la loi séparatisme doit être compatible avec l’article 10 de la CEDH sur la liberté d’expression1, et l’article XI de la CEDH sur la liberté de réunion et d’association2, et l’article 22 du Pacte international des droits civils et politiques3 qui consacre aussi la liberté de réunion et d’association. ».
L’affaire des Soulèvements de la Terre, dont le Sénat a retoqué la dissolution 9 novembre 2023 est considérée comme une victoire. « Mais c’est une victoire paradoxale, explique Emma Marc. Si l’association n’a pas été dissoute, les juges se sont appuyés sur trois critères qui élargissent les possibilités de dissolution : “l’incitation explicite ou implicite à des agissements violents ; le fait de légitimer des agissements d’une particulière gravité ; le fait de rester inactif face à des incitations à commettre des actes violents”. En l’occurrence, ils ont estimé que les dégradations aux biens constatées ne justifiaient pas la dissolution, mais qu’en serait-il avec une association moins soutenue médiatiquement et sur le terrain ? ».
En résumé, Emma Marc voit deux pistes de ripostes juridiques : obtenir une qualification juridique précise de ce qu’est « l’incompatibilité avec le CER« , et imposer la reconnaissance du droit à la désobéissance civile dans le cadre du CER. Elle souligne également un autre argument juridique, qui s’applique au cas de Radio U en Bretagne face au pouvoir discrétionnaire du préfet : la loi de 1901 ne permet pas à l’administration de s’immiscer dans la gestion des salariés des associations.
L’heure est à la vigilance : un rapport sénatorial a souligné le peu d’efficacité de la loi contre le séparatisme, estimant précisément que son angle mort résidait dans les subventions des collectivités. Ses préconisations (nomination d’un sous-préfet dédié au « respect des valeurs de la République » et transmissions systématiques des demandes de subventions aux préfets) accentuent la dimension liberticide du CER et le pouvoir des préfets face à la libre administration des collectivités.
Face à ce danger, trois associations ont saisi le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) pour borner les prérogatives des préfets. Et une initiative prévoit de désigner annuellement le pire préfet pour les libertés associatives !
Entre autocensure et étouffement
Si les sanctions prises au nom du CER ont été limitées et souvent retoquées par la justice, le dispositif a réussi à imposer une chape de plomb et les conditions d’une autocensure, souligne Xavier Milliner, citant les débats intervenus à Radio U sur la pérennité du soutien à L’Avenir.
Jean-Baptiste Jobard rappelle, loin d’une approche corporatiste, que la défense des libertés associatives est la défense des libertés de réunion, de manifestation, d’expression, de création, d’opinion, piliers de la démocratie. C’est à partir de là qu’un système d’alliances peut se nouer avec des élu·es locaux, pour certain·es très impliqué·es : l’effet du CER sur les subventions s’oppose au principe de libre administration des collectivités affirmé dans la Constitution.

« Il y a trois fronts de riposte face à ces attaques, conclut-il. Nous avons monté un module de formation pour les associations dont la première étape consiste à caractériser une atteinte : quel est le nom de l’attaque ou l’entrave à la liberté d’une association ? Qui en est l’auteur ? De quelle manière ? Quelles en sont les conséquences ? C’est sur la base de ce travail d’analyse que l’on construit une stratégie interne et externe. Le mot d’ordre, c’est “Ne restez surtout pas seul·es !” pour faire comprendre qu’une attaque contre les associations est une attaque contre l’ensemble des activités associatives. En Bretagne, le communiqué : Nous ne voulons pas d’un monde associatif qui se tient sage a montré l’importance de riposter collectivement ! Outre le juridique et la mobilisation collective, la question est souvent celle d’une réponse sur le front médiatique ; là encore, l’exemple de la Bretagne qui a qualifié le CER de contrat-baillon dans un communiqué en est un bon exemple. Mais cette stratégie médiatique suppose une forte préparation en amont. Un fort relais médiatique et un soutien collectif aux associations frappées par une sanction permet de porter une question locale au niveau national. »
Au-delà, l’enjeu des mobilisations associatives a en ligne de mire l’abrogation du CER. « Quand, en 2022, le mouvement associatif national a fait passer un “grand oral” à tous·tes les candidat·es à l’élection présidentielle, ils ont posé une question flash : « abrogerez-vous le contrat d’engagement républicain ? » Tous les candidats de gauche s’y sont engagés. Ça donne des pistes de travail au niveau local. », estime Jean-Baptiste Jobard. Dans plusieurs municipalités, la charte des engagements réciproques propose d’ailleurs un modèle « d’anti CER », reposant sur la confiance mutuelle des associations et des collectivités qui les soutiennent.
Plusieurs participant·es le font remarquer : ce grignotage des libertés associatives s’inscrit dans un processus d’extrême droitisation de la société, où d’autres libertés comme celle de manifestation sont régulièrement attaquées et où l’État de droit fait l’objet de remises en question régulières.
Le CER est un outil d’un dispositif qui voit le néolibéralisme entrer dans une phase d’autoritarisme : il faudrait réussir une mobilisation globale sur la question de la démocratie, qui est attaquée de manière générale et frontale.
- Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Convention européenne des droits de l’homme. ↩︎
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Convention européenne des droits de l’homme. ↩︎
- Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ↩︎
Cette synthèse a été rédigée par Valérie de Saint-Do pour l’UFISC.

Ressources
Libertés associatives et Contrat d’engagement républicain (CER)
Libertés associatives et initiative citoyenne
| Une histoire des libertés associatives. De 1791 à nos jours | Ouvrage de Jean-Baptiste Jobard. Editions Charles Léopold Mayer, 2022. |
| Vidéo courte / Une histoire des libertés associatives | Présentation de l’ouvrage par Jean-Baptiste Jobard. |
| Vidéo / Une histoire des libertés associatives | Une session de l’Université des Savoirs Associatifs autour de l’ouvrage. |
| Droit & Mouvements Sociaux (DMS) | En savoir plus sur cet espace de travail au service de l’outillage juridique des assos |
| Une nouvelle chasse aux sorcières » contre les associations | Enquête de l’Observatoire des libertés associatives |
| Une citoyenneté réprimée | Enquête de l’Observatoire des libertés associative |
A découvrir aussi…
-
Pour mieux faire solidarité, résister et créer avec les droits culturels !
Les droits culturels sont inscrits depuis 1948 dans les droits humains fondamentaux. Les prendre en compte dans nos pratiques permet un regard renouvelé sur les personnes, leur dignité, leurs modes de vie et sur les relations qui les lient. Ils s’imbriquent aux luttes pour la diversité culturelle, l’intersectionnalité, les mouvements sociaux, la défense du vivant.…
-
Libertés associatives, qu’induit le nouveau cadre légal ?
Deux ateliers successifs se sont penchés sur les dangers qui menacent – voire entravent effectivement – les libertés associatives. Le premier, le 13 mai, plantait le décor, avec un point de situation global, et esquissait des pistes de solution. Le deuxième s’est plus spécifiquement penché sur le contenu et les incidences du Contrat d’engagement républicain…
-
Oralisation du langage inclusif
Conçu et réalisé par Léna Salabert-Triby et Lise Lépinay, Pays de Glossolalie* est un projet éditorial de traduction et d’oralisation de contes traditionnels en langues inclusives et post-binaires. Ce projet participe à la diffusion, la sensibilisation et l’expérimentation de ces nouveaux langages aux formes variées et diverses.
-
Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ?
Les droits culturels propose une ligne éthique pour reconsidérer nos relations entre humains et nos rapports au vivant. Cette ligne peut se lire comme une injonction à la dignité, et plus encore aux dignités réciproques. Nommée à plusieurs reprises dans la Déclaration de Fribourg, la dignité est une notion majeure qui n’est pas si simple…
-
L’art au service de la revendication politique des personnes concernées : l’exemple du parlement de rue pour d’autres politiques migratoires
A partir de l’expérience du Parlement de rue pour d’autres politiques migratoires, dynamique interassociative née fin 2022 dans le cadre de la mobilisation contre la loi Asile et Immigration, cet atelier propose de réfléchir au rôle politique de l’art dans la sensibilisation et la mobilisation pour l’accueil et les droits des personnes exilées.



